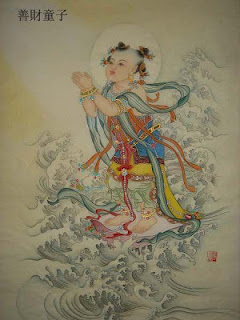J’ai réfléchi à ce qui me gênait dans l’organisation post-mortem de Sogyal Lakar (Le parinirvana de Sogyal Rinpoché, les hommages qui lui sont rendus, la tournée du koudoung, etc.), et j’ai trouvé la piste que voici.
“Tout est organisé comme si le décès de Sogyal Lakar était le parinirvana d’un grand maître tibétain “réalisé”. “Sogyal Rinpoché demeure en ce moment en thoukdam. Cet état se produit lorsqu’un pratiquant qui a atteint la réalisation continue, au moment de la mort, continue à reposer dans la reconnaissance de la nature de l’esprit.” Source Rigpa. Son “Corps”, appelé “sku gdung” (koudoung) est actuellement en Thaïlande, mais partira bientôt en tournée pour permettre aux disciples de Sogyal Lakar de lui rendre un dernier hommage (Bangkok, Lerab Ling en France, Bodhgaya en Inde à Shéchen Gompa, Gangtok au Sikkim). Le Koudoung sera finalement incinéré, tout comme celui de Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö JKCL), à Tashiding au Sikkim, un des huit grands charniers béni par Guru Rinpoché, et où se trouve le stupa avec les reliques de JKCL.” Blog Verticalité ou horizontalité du bouddhisme, une question religio-politique ?En pensant au traitement que Sogyal Lakar fit subir, de son vivant, à certains adeptes, et à son comportement décrit dans le rapport Lewis Silkin, il y a quelque chose de dérangeant dans le fait que son corps, traité comme un relique (sku gdung), fait la tournée du monde pour donner l’occasion aux adeptes de rendre un dernier hommage. Imaginons la même chose avec Harvey Weinstein, mourant avant son procès, dont le corps serait promené pour que les stars de Hollywood puissent lui dire un dernier adieu.
La particularité de Sogyal Lakar est qu’il était un maître spirituel et le tulkou (contesté) du terteun Lerab Lingpa. Même en tant que tulkou, son statut était particulier, car les tulkous du terteun Lerab Lingpa n’ont (pour autant que je sache) pas de patrimoine à gérer, ni d’office (ladrang) pour gérer la fonction du tulkou[1]. C’est important, car dans le cas d’un tulkou officiel, comme p.e. le Dalaï-Lama, son statut est un peu comme un roi, qui a deux corps.
“Comme l’avait remarqué Ernst Kantorowicz[2] pour des rois européens, le roi a deux corps : un « corps terrestre et mortel, tout en incarnant le corps politique et immortel, la communauté constituée par le royaume ».[3]
« Parce qu'il est naturellement un homme mortel, le roi souffre, doute, se trompe parfois : il n'est ni infaillible, ni intouchable, et en aucune manière l'ombre de Dieu sur Terre comme le souverain peut l'être en régime théocratique. Mais dans ce corps mortel du roi vient se loger le corps immortel du royaume que le roi transmet à son successeur. » ‘Les Deux Corps du roi’ d'Ernst Kantorowicz, Patrick Boucheron L'Histoire, no 315 - décembre 2006.Sans concevoir la moindre pensée ni produire le moindre effort, un Bouddha fait cependant le bien des êtres, spontanément et sans interruption. A travers des manifestations qui sont comme les rayons de soleil (source Gampopa). C’est l’idée derrière les nirmāṇakāya, tulkou, en tibétain, qui s’apparentent cependant plus aux avatars de l’hindouisme, mais alors sous la forme d’une dynastie des mêmes tulkous. Au lieu de naître dans une dynastie, les tulkous officiels (avec un office) re-naissent dans la même dynastie. Et ils ont alors deux corps, tout comme les rois, dont le premier corps est sa fonction. Cette fonction ne peut être qu’impeccable. C’est elle qu’on pleure à la mort du roi ou tulkou officiel. L’homme, imparfait, n’en était que le support.
“Quand un roi meurt à Purī, on avertit le futur roi : « Un inconnu (bideśi) a été trouvé mort dans le palais. » Ce n’est après tout que le corps natif (sahaja-kāya) précédent du roi, qui, immortel, séjourne désormais dans le corps de son fils. Le prince reçoit alors un couronnement temporaire (asthāyiabhiśeka).” Blog Un roi qui fait la pluie et le beau tempsIl en va de même à la mort d’un tulkou officiel, on pleure la perte temporaire de la fonction, on lui rend hommage, on lui adresse des cérémonies, on lui construit un stupa pour accueillir ses reliques, et on s’occupe du successeur.
Sogyal Lakar est comme un self-made tulkou pas fini, éventuellement à venir dans le cas d'une sanctification réussie. Ici, les hagiographes veulent aller plus vite que la réalité. Il n’avait pas de corps fonctionnel, car il n’avait pas de fonction officielle. Le corps qui fait le tour du monde est le corps de l’homme Sogyal, imparfait. Nous nous trouvons devant un des principaux maux de l’évolution du bouddhisme tibétain en occident : la personnalisation du rôle du gourou, qui fait du bouddhisme un bouddhisme people. Le corps et la vie ordinaire de l’individu gourou ou tulkou sont confondus avec son corps fonctionnel, et vice versa. Et c’est très problématique. Car comment rendre hommage à ce corps-ci, célébrer cette vie individuelle-là comme un nirmāṇakāya, comme un Bouddha en parinirvāṇa ?
Cette notion du double corps (même si elle est bancale dans le cas de Sogyal Lakar) est peut-être en même temps un début d'explication du décalage entre l’attitude des occidentaux et les tibétains. Les occidentaux pensent surtout à l’homme Sogyal (corps natif) et les accusations portées contre lui, les tibétains pensent plutôt au “tulkou” et “gourou” (corps fonctionnel), et rendent hommage à sa fonction, ou à ce qu’il aurait dû être.
[1] Imaeda, Yoshiro (今枝由郎) observe dans son étude [Histoire médiévale du Bhoutan : établissement et évolution de la théocratie des 'Brug pa / Imaeda Yoshiro. - Tokyo : Toyo Bunko, 2011. - xi, 259 S. : Kt. - (Toyo Bunko research library ; 14)] que l'institution des tulkus, qui a été instaurée suite à des problèmes de succession au trône, "recouvre en fait deux réalités différentes qu'il faut bien distinguer : des réincarnations, ou plutôt émanations, à caractère purement "spirituel" d'un côté, et celles à double implication, religieuse et séculière, de l'autre."
"Dans la première catégorie, la réincarnation/émanation qui correspond au "corps de transformation" (sprul sku = nirmânakâya en sanskrit) n'hérite pas les propriétés incluant le(s) monastère(s) qui appartenai(en)t à sa précédente réincarnation/émanation. En revanche, la réincarnation de la seconde catégorie (le même terme honorifique sprul sku s'applique à cette catégorie comme à la première, mais yang srid, "l'existence à nouveau" en terme ordinaire ne concerne que la seconde) acquiert non seulement les qualités spirituelles de la réincarnation/ émanation de la première catégorie, mais aussi le droit de monter sur le trône de son prédécesseur et d'hériter le(s) monastère(s) aussi bien que les propriétés qui lui appartenaient de son vivant."
[2] The King’s Two Bodies. A study on medieval political theology, 1957.
[3] Voir mon blog Un roi qui fait la pluie et le beau temps
***
[1] Imaeda, Yoshiro (今枝由郎) observe dans son étude [Histoire médiévale du Bhoutan : établissement et évolution de la théocratie des 'Brug pa / Imaeda Yoshiro. - Tokyo : Toyo Bunko, 2011. - xi, 259 S. : Kt. - (Toyo Bunko research library ; 14)] que l'institution des tulkus, qui a été instaurée suite à des problèmes de succession au trône, "recouvre en fait deux réalités différentes qu'il faut bien distinguer : des réincarnations, ou plutôt émanations, à caractère purement "spirituel" d'un côté, et celles à double implication, religieuse et séculière, de l'autre."
"Dans la première catégorie, la réincarnation/émanation qui correspond au "corps de transformation" (sprul sku = nirmânakâya en sanskrit) n'hérite pas les propriétés incluant le(s) monastère(s) qui appartenai(en)t à sa précédente réincarnation/émanation. En revanche, la réincarnation de la seconde catégorie (le même terme honorifique sprul sku s'applique à cette catégorie comme à la première, mais yang srid, "l'existence à nouveau" en terme ordinaire ne concerne que la seconde) acquiert non seulement les qualités spirituelles de la réincarnation/ émanation de la première catégorie, mais aussi le droit de monter sur le trône de son prédécesseur et d'hériter le(s) monastère(s) aussi bien que les propriétés qui lui appartenaient de son vivant."
[2] The King’s Two Bodies. A study on medieval political theology, 1957.
[3] Voir mon blog Un roi qui fait la pluie et le beau temps