Le
Manimékhalaï est riche en informations sur le sud de l’Inde et l’état du bouddhisme entre le 3ème et le 6ème siècle (sans exclure la possibilité d'une composition postérieure). Les diverses sectes que l’on rencontre dans ce conte ont chacune leurs propres caractéristiques, mais tous les membres des divers sectes sont aussi les sujets de leurs royaumes respectifs. Quelques soient les croyances spécifiques de leur secte, ils partagent la même croyance que les dieux sont les gestionnaires de leur territoire. En fait, les croyances spécifiques des sectes concernent surtout le discours et les méthodes se rapportant à la libération (
mokṣa). Pour le reste, ils semblent plus ou moins d’accord sur les pouvoirs des dieux, des planètes, des divers génies et nymphes et sur l’importance de les honorer. Les rois sont les représentants locaux d’
Indra, et ils se rapportent par rapport à leur roi, comme les autres dieux et êtres surnaturels par rapport à Indra.
Il y a donc comme un culte officiel auquel participe tout le monde, quel que soit la secte à laquelle on appartient. Le
Manimékhalaï fait l’apologie du bouddhisme, mais montre que ces héros et héroïnes participent en même temps au culte officiel local. Le culte local s’inscrit dans la
mythologie du territoire. Le territoire dans notre contre est le Continent du Jambousier (Continent du Bois de Rose,
Jambudvīpa) dont l’Inde est le centre. Champou ou Champapati (
Pārvatī) est la déesse de la Terre et la protectrice de tout le continent et Manimékhala est la déesse de l’Océan.
Amaravati est considéré être la capitale d’Indra. Les capitales des
trois royaumes (Chéra, Pandya et Chola) ont
chacune une déesse protectrice qui protège la ville et qui la rend prospère. Il y a Champapati à Puhār (Chola), Madurapati à Madurai (Pandya) et à Kannaki/Kannagi à Vanji (Chéra). Dans leurs temples respectifs, ces déesses ont des statues qui les représentent iconiquement. Elles parlent et donnent conseil à l’héroïne.
Kannaki/Kannagi et son mari Kovalan, avaient acquis le statut des dieux de Vanji, mais la déesse explique à Manimékhalaï, que lorsqu’ils auront épuisé leur crédit, qu’il faudrait payer pour leurs mauvaises actions. Elle lui apprend en outre qu’Indra aurait construit sept monastères (
vihāra) bouddhistes dans la ville (engloutie) de Puhār en l’honneur du Bouddha.
[1]
Tous les lieux, montagnes, collines, fleuves etc. ont d’ailleurs leur dieu protecteur. Souvent une déesse dans le sud. A certains endroits des piédestaux du Bouddha ont été édifié, qui les
représentent aniconiquement. Le Bouddha ne parle pas et ne donne pas conseil à l’héroïne. Mais ces lieux sont gardés par des déesses, qui elles sont accessibles.
« Il nous suffira de savoir qu’après avoir fait de la matière une cause première, un Dieu, on a divinisé la terre, ses parties principales, les montagnes, les mers, les fleuves, les fontaines. On a fait des quatre éléments des génies présidant aux quatre saisons ; on a été jusqu’à les faire présider à tels signes du zodiaque, à telles constellations. On ne s’en est pas tenu là : on a affecté au feu le principe du chaud, à l’air celui du froid, à l’eau celui de l’humide, et à la terre celui du sec. On a personnifié ces quatre principes, et on a imaginé qu’ils dominaient chacun dans des astres, et que ces signes, ces astres, et ces principes, modifiaient et gouvernaient toutes les choses d'ici-bas. Tout cela a fourni ample matière à l’astrologie, et a donné lieu à d'immenses généalogies de dieux, et à de nombreuses fables : c’est tout ce que nous avons besoin d’en savoir. » (Extrait de chapitre 4 de l'Analyse raisonnée de l'origine de tous les cultes, ou Religion universelle par Antoine Louis Claude Destutt de Tracy)
Tous les phénomènes sont ainsi doublés de leurs agents respectifs, qui servent de médiateur. Le monde céleste
est ainsi imprimé sur le monde terrestre et le dirige. La
terre prend modèle sur le ciel, à commencer par l’idée
d’hiérarchie. Les palais royaux prennent modèle sur le palais d’Indra, et l’univers est reproduit en miniature. Le réseau recouvrant la réalité qui a le dieu Indra pour centre est donc véritablement comme le
filet d’Indra (
indrajala), qui est un synonyme pour la Māyā. Pour commémorer par exemple la venue de tous les dieux dans
le terrible cimetière («
Shudukāttu-Kottam ») de Puhār, «
Māyā, l’abile architecte divin, y a construit, avec de l’argile et du stuc, un temple à l’image des demeures des dieux. Au centre est représenté l’axe du monde, le mont Mérou, encerclé des sept chaînes de montagnes et des quatre continents, entouré d’îles au nombre de deux mille. Sur chaque continent sont indiqués les sites les plus remarquables, l’apparence de ses habitants et le style de leurs maisons. »
[2] Tous ces dieux et agents ne sont pas des philanthropes et
réclament leur dû. Le roi de Chola, en de bons termes avec Indra, avait prié celui-ci de venir tous les ans avec tous les dieux pour un festival de 28 jours. Pendant ce festival, il y arriva que des dieux, des génies etc. «
s’étaient dépouillés de leur gloire afin de ressembler à des hommes, » et circulaient librement dans la ville. «
On prétendait que, si l’on négligeait l’ordonnance des fêtes, le génie protecteur de la ville entrerait en fureur. »
[3] Les génies dans le
Manimékhalaï sont présents aux carrefours et aux croisements, leurs
représentations gravées dans des piliers. Le culte des dieux, quel que soit son appartenance sectaire, est nécessaire «
pour contrecarrer l’influence des planètes néfastes et les intrigues des perfides démons. »
[4] C’est d’ailleurs à cause d’avoir manqué à ses obligations que la ville de Puhār fut engloutie par un tsunami.
La religion, la chose publique, est une chose et la libération individuelle (
mokṣa) en est une autre. Il y avait une liberté de sectes, mais aussi comme une obligation de religion. Nous sommes évidemment à une période où le bouddhisme a réintégré la ville et que les bhikkhus ne sont plus de véritables mendiants (certains disent même qu’ils seraient
devenus des banquiers). Ils participent donc pleinement à la vie en société. Si une secte ne participait pas au culte officiel et si par malheur une catastrophe naturelle s’ensuivrait, on peut être certain que celle-ci leur serait imputée.
Manimékhalaï n’érigerai pas seulement des piédestaux de Bouddha, mais «
elle fit aussi construire un temple avec des statues de Tivatilakaï [genie protecteur du piédestal dans l’île Manipallavam ] et de la déesse [de la mer, qui avait sauvé son père, et d’après qui elle avait été nommée] »
[5]. Elle accomplit ainsi ses devoirs de « bouddhiste » et du « culte commun ». Elle est un bon sujet.
On pourrait voir les dieux comme des colonisateurs. Ils habitent les cieux mais ont colonisé la terre, où ils ont installé des agents à tous les endroits stratégiques. Si les terriens veulent obtenir des faveurs, ils doivent s’adresser aux dieux ou à leurs agents et représentants, afin de les obtenir. Les « dieux » ont pour fonction de pourvoir à tous les besoins matériels, à tout ce dont on a besoin pour vivre, et de détourner (ou causer…) les catastrophes naturelles, à faire tomber la pluie etc. C’est cela, le premier et véritable sens de religion. Quand le Christ dit «
Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu », la part de « César » correspondrait plutôt à celle de la religion, telle que nous venons d’en parler. La part de Dieu, du Christ serait plutôt celle du salut (
mokṣa). Bien public, bien individuel.
Il semblerait donc qu’il ne faut pas confondre dans la tradition bouddhiste ce qui relève de « César » et ce qui relève du salut intime. C’est cette attitude, qui, selon moi, explique la présence de
Gaja-Lakṣmī dans les grottes « hīnayāna », le geste de Manimékhalaï de construire un temple de dieux « hindous », l’habitude des bouddhistes d’adresser des prières à
Kubera etc. Nous sommes encore dans une société où la «
magie antique » joue un rôle important,
à défaut de science véritable. On s’adresse tout simplement aux
gestionnaires du monde. La magie antique relève de la société et de son organisation. Elle n’a rien à voir avec le salut.
Dans un premier temps, quand les bouddhistes suivirent l’idéal du renonçant, l’objectif était une sortie du monde et l’Extinction. Dans un deuxième temps, sans doute en réaction aux épopées indiennes qui proposèrent un idéal d’engagement, d’accomplissement des devoirs, le bouddhisme a mis en avant l’idéal du bodhisattva également engagé dans le monde. Et pour vraiment être capable d’agir dans le monde, il faut connaître les voies de celui-ci. Il faut avoir
les bonnes relations, de bons réseaux, et à défaut d’experts en science, s’entourer de
bon spécialistes en magie antique, en religion.
***
[1] Daniélou, p. 219
[2] Daniélou, p. 69
[3] Daniélou, p. 26. C’est d’ailleurs un
vidyadhāra qui coupera le prince Udhayakumāra en deux avec son épée, à cause d’un qui pro quo, mais cet acte sera néanmoins considéré comme justice. Comment distinguer dans ce monde, où les être surnaturels peuvent prendre la forme de simple mortels, les uns des autres ? Et si les êtres surnaturels n’existaient pas, qui aurait coupé en deux le prince Udhayakumāra de Chola ?
[4] Daniélou, p. 27
[5] Daniélou, p. 255









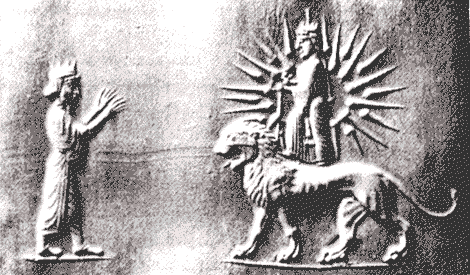













 Mais
Mais 
 On voit une Femme à cornes (avec un disque solaire au centre ?) devant/dans un arbre à deux branches (
On voit une Femme à cornes (avec un disque solaire au centre ?) devant/dans un arbre à deux branches (






