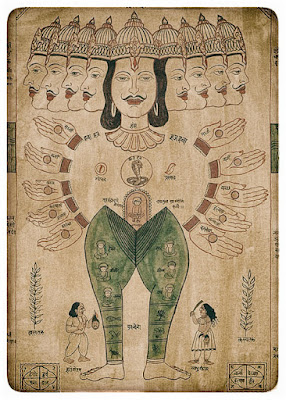|
| Femmes apprenant un enfant à marcher, Rembrandt, British Museum |
Quand on aborde un groupe ou une communauté bouddhiste, le mot “pratiquer” tombe souvent rapidement, et à répétition. Si “pratiquer”, c’est mettre en pratique une théorie, ou une doctrine, quelle est la doctrine (pariyatti) du bouddhisme, ou plutôt des “bouddhismes”, qui est mise en pratique ? Quel est l’objectif de cette doctrine, dans quel but (paṭivedha), pratique-t-on ? Ou peut-être, la pratique précède-t-elle la doctrine, et la doctrine est apparue du cheminement (paṭipatti) de Siddharta Gautama, connu sous le nom “Buddha” ?
Selon la notion de “l’octuple chemin” (aṭṭhaṅgika-magga), qui semble assez ancienne, “la pratique” consiste à marcher dans les pas de Siddharta Gautama, en “développant” 1. une compréhension juste (sammā-diṭṭhi / samyag-dṛṣṭi), 2. une pensée juste (sammā-saṅkappa / samyak-saṃkalpa), 3. une parole juste (sammā-vācā / samyag-vāc), 4. une action juste (sammā-kammanta / samyak-karmānta), 5. des moyens d'existence justes (sammā-ājīva / samyag-ājīva), 6. un effort juste (sammā-vāyāma / samyag-vyāyāma), 7. une attention juste (sammā-sati / samyak-smṛti) et 8. une concentration juste (sammā-samādhi / samyak-samādhi). Ce chemin est à la fois un moyen pour atteindre la libération (Nibbāna/Nirvāṇa) et, dans une certaine mesure, la libération (mokṣa) elle-même, dans sa manifestation progressive.
Ce chemin rejoint la notion du “triple entraînement” (trisiśikṣā / tisikkhā), c’est-à-dire l’entraînement en la conduite éthique (śīla) -- la pensée juste, la parole juste et l’action juste -- ; la concentration méditative (samādhi, jhāna, dhyāna) ; la lucidité ou sapience (paññā, prajñā, t. shes rab), une connaissance élevée.
Le chemin est tracé au sein de l’expérience humaine (loka), constituée de données sensorielles (paccakkha, pratyakṣa), idées, raisonnements (anumāna), conventions, symboles etc., tous porteurs de sens. Bref, un champ de circonstances et conditions dépendantes (paṭiccasamuppāda, pratītyasamutpāda). Le bouddhisme ne nie pas la réalité de ce champ, ultérieurement qualifié de conventionnel ou relatif (sammuti-sacca, saṃvṛtisatya). Cependant, l’expérience humaine a pour triple marque (tilakkhaṇa, trilakṣaṇa) d’être temporelle/impermanente (anicca), imparfaite (dukkha) et sans essence (anattā). Ces trois marques sont considérées comme une sorte de réalité ultime (paramattha-sacca, paramārthasatya) de l’expérience temporelle.
Le bouddhisme se considère comme une voie de milieu (madhyamaka), dans le sens qu’elle ne s’investit ni uniquement dans les conditions dépendantes constituant l’expérience humaine, ni dans la “réalité ultime” de ses trois marques, également sans essence (suññatā / śūnyatā). La libération (mokṣa) consisterait à avoir simultanément accès aux deux niveaux : agir, vivre, parler au niveau conventionnel, tout en voyant plus profondément (vipaśyanā) que ceux-ci sont sans essence, impermanents, interdépendants.
C’est précisément cette radicalité qui fait la singularité du bouddhisme par rapport au brahmanisme environnant et à d’autres traditions. Là où le brahmanisme postulait un principe ultime (Ātman, Brahman), le bouddhisme refusa toute essence fixe. Ce qui “reste” si on pouvait écarter “la couche” des concepts (vikalpa) n’est pas un Absolu substantiel, mais le “tel quel” (tathatā), “irréductible” à nos “constructions”.
Je pourrais placer des guillemets (scare quotes) partout, ce que je ne ferai pas, mais je veux néanmoins souligner l’arbitraire des catégories créées au sein de la pensée, qui ne sont probablement pas autres que “la pensée”, et donc du langage.
« Je voy les philosophes Pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur generale conception en aucune maniere de parler : car il leur faudroit un nouveau langage. Le nostre est tout formé de propositions affirmatives, qui leur sont du tout ennemies… » Montaigne, Apologie de Raymond de SebondeLa singularité du bouddhisme fut d’oser affirmer qu’aucune essence n’existe derrière les phénomènes. Cette absence d’essence (niḥsvabhāvaḥ) est aussi appelée “vacuité”.
« La Nature est l’Être […], entendant par là ce qui demeure. Mais aucun être ne demeure. La Nature n’est pas un être, mais la source d’où être et non-être ont leur jaillissement. « Source », « jaillissement » : je parle par métaphores. Mais quel autre langage serait possible ? Car le mot « infini » ne dit pas la source comme telle dans son activité. Disons une force créatrice de formes et qui, après toutes ses créations, est toujours autant capable de nouvelles créations : donc une force qui ne faiblit pas. Langage métaphorique. » (Marcel Conche, Présence de la Nature, p. 81)Quand on fait abstraction de “l’expérience humaine” (loka) et ce qui est recouvert par elle, il reste “le réel” “pré-monde” tel quel, indépendant du mental (mind-independent). Il ne s’agit pas de s’unir ou s’identifier à lui, de demeurer en lui, de se dissoudre en lui. Il n’y a pas d’objectif religieux de ce genre.
Il ne s’agit pas non plus de définir une couche purement consciente (voire “lumineuse”) comme la substance réelle de la couche psychosensorielle ou conceptuelle, une conscience sans contenu, qui se connaît elle-même (svasaṃvedana). Si l’on conçoit une telle couche, recouvrait-elle le réel humain, “le chaos” ? Serait-elle elle-même ce “réel” ? Esotériquement, elle est souvent définie comme tout le réel, et ce serait uniquement sa non-connaissance (avidyā), comme l’ombre de la connaissance lumineuse, qui est mise en cause pour la fausse réalité humaine. Quand tout est conscience, la dualité “esprit-matière” n’est que la conséquence de la non-connaissance ou reconnaissance de la conscience comme le réel lumineux. Cette non-connaissance même est l’avidyā, créateur de dualité…
La singularité du bouddhisme est de laisser telle quelle la dualité, qui est le cadre naturel de toute connaissance, mais sans s’investir unilatéralement dans un aspect de la “dualité”, que ce soit la réalité conventionnelle ou ultime. Le non-investissement donne accès à la “libération”, ou plutôt à un non-asservissement. Le potentiel “altruiste” (karuṇā) est entièrement préservé, et même augmenté, théoriquement délesté des passions, de la dualité (vikalpa) et de l’agir (individuel). La conscience et son objet, “son ombre” (“l’illusion”) restent tout entières. Il n’est pas besoin d’amender la dualité en la transcendant ou en l’intégrant dans un monisme de pure conscience, où l’ombre “n’est pas”, et ne serait qu’illusion.
On pourrait faire une comparaison avec l’hermétisme égyptien tel qu’il est exposé par Garth Fowden dans The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pagan Mind (Cambridge University Press, 1986). Dans le chapitre 4 Religio Mentis, Fowden distingue deux sortes de connaissance : l'épistémè (science), produit de la raison (logos) et du langage, et la gnose (gnôsis), une “connaissance supérieure” issue de la faculté d'atteindre la vérité par l'intuition (noèsis) et de la foi. La raison guide "jusqu'à un certain point" mais ne peut atteindre la vérité ultime. L'âme doit ensuite procéder seule vers la foi (pistis), selon le principe hermétique : "avoir compris, c'est avoir cru".
"Ni la raison en général, ni spécifiquement le discours hermétique - le mot logos pouvant bien sûr signifier l'un ou l'autre - ne peuvent par eux-mêmes conduire à la vérité. Le logos guide l'intellect « jusqu'à un certain point » ; mais dès lors l'intellect doit procéder seul, n'ayant pour comparer ses expériences que la réminiscence des enseignements qu'il a reçus dans la sphère de la raison. De cette manière l'intellect peut finalement parvenir à la foi (pistis) - « car avoir compris, c'est avoir cru (tô gàr noêsai esti tô pisteusai), et ne pas avoir compris, c'est ne pas avoir cru ». On ne saurait souhaiter formulation plus concise de la conviction des anciens que la connaissance humaine et divine, la raison et l'intuition, sont interdépendantes - conception qui continua de prévaloir en Islam, particulièrement dans les milieux chiites et soufis, mais que la tradition intellectuelle occidentale a souvent rejetée, décomposant la connaissance en catégories indépendantes, séparant la philosophie de la théologie, et ce faisant érigeant de sérieux obstacles à la compréhension de visions du monde plus unifiées.” (Fowden 1986[1])Selon Fowden, cette intuition supérieure ou d’une réalité supérieure (gnose) n'est ni purement moniste ni strictement dualiste, mais présente une tension caractéristique entre éléments monistes (divinisation de l'initié, reconnaissance de la nature divine de l'homme) et des éléments dualistes : désir d'évasion du monde matériel, transcendance divine.
Si l'âme (“le coeur”) devient l'organe direct du Logos, la raison devient-elle superflue, une simple illusion ? Dans l’hermétisme égyptien, selon Fowden, il s’agit d’une hiérarchisation plutôt qu'une abolition - la raison reste nécessaire pour la préparation et la transmission. La gnose hermétique comporte cependant une dimension moniste forte. Fowden souligne que l'initiation conduit à une "assomption par l'initié des attributs de Dieu : en bref, la divinisation". L'homme rené (“reborn”. Born again ?) peut "lui-même être appelé équitablement un dieu". Cette union transformatrice suggère un dépassement de la dualité sujet-objet caractéristique de la connaissance rationnelle[2].
Pour les hermétistes, l’homme divinisé peut même être supérieur aux dieux, de par son incarnation terrestre. Chapitre X du Corpus Hermeticum (trad. Fowden 1986). Il aurait quelque chose de plus… Comme dans le film Wings of Desire (1987) de Wim Wenders.
“L'Homme est un être divin (θεῖον ὂν), qu'il faut comparer non pas aux autres créatures terrestres, mais à ceux que l'on appelle dieux, là-haut dans les cieux. Bien plus, si l'on doit oser dire la vérité, l'Homme véritable est au-dessus même des dieux, ou du moins pleinement leur égal.L'initiation hermétique implique une "invasion de l'initié par le Noûs divin" qui résulte en une "construction du Logos", c'est-à-dire la reconstruction de l'Homme essentiel original. Cette expérience apporte à l'initié "une parenté inaliénable avec le monde divin" (Fowden 1986). Malgré une dimension moniste forte, Fowden identifie aussi des "éléments dualistes" dans l'hermétisme. Il note que la progression de l'epistēmē vers la gnōsis peut conduire à "dévaluer le Monde et l'Homme" et à "cultiver une philosophie de tendance dualiste" qui "souligne la nature transcendante de la Divinité"[4].
Après tout, aucun des dieux célestes ne quittera les frontières célestes pour descendre sur terre ; pourtant l'Homme monte jusque dans les cieux, et les mesure, et connaît leurs hauteurs et leurs profondeurs, et tout le reste à leur sujet, il l'apprend avec exactitude. Plus remarquable encore, il s'établit dans les hauteurs sans même quitter la terre, tant s'étend son pouvoir.
Nous devons donc oser dire que l'Homme terrestre est un dieu mortel, et que le Dieu céleste est un homme immortel. Et c'est ainsi que par ces deux-là, le monde et l'Homme, toutes choses existent ; mais elles furent toutes créées par l'Un.[3]”
Les monismes semblent incapables de se débarrasser d’une hiérarchie (“Dieu”-Monde-Homme), et par là de “la dualité” en maintenant une distinction entre incarné et désincarné, et entre le temporel et l'éternel. Ils visent la "libération de ce monde de flux et de matérialité" plutôt qu'une reconnaissance de leur unité fondamentale[5]. La gnose hermétique apparaît comme une forme hybride : elle utilise des éléments monistes (unité divine-humaine) au service d'un projet essentiellement dualiste (évasion du monde matériel), créant une tension doctrinale que Fowden identifie comme caractéristique de cette tradition.
Il me semble que des choses similaires pourraient être dites des formes monistes ou monothéisantes (Yogācāra, tathāgatagarbha, ésotérisme, …) du bouddhisme, et qui s'éloignent ainsi de ce qui me semble être la singularité du bouddhisme, mentionné plus haut. La voie du milieu est un non-investissement, la dualité n’est ni détruite ni dissoute par l’imposition d’un monisme, introduisant par là même des hiérarchies de tout genre. Elle crée un espace, qui peut être bénéfique, quelle que soit la nature de cet espace. Est-ce un espace au sein même de l’expérience humaine, en dehors d’elle, la substance première universelle… ? Cela a peu d’importance (voir la parabole de l’homme blessé par une flèche empoisonnée MN63).
Le bouddhisme tel qu’il est pensé et pratiqué de nos jours, et dans son ensemble, apparaît cependant aussi comme une forme hybride. Parfois, il se veut plutôt rationnel, avec un Bouddha humain (Siddharta Gautama), qui trouve le nibbana, mais sans pour autant accéder à une réalité qui serait supérieure ou autre. Le plus souvent, et dans le vécu des traditions, c’est l’accès à une réalité supérieure, diversement définie, qui constituerait le salut, individuel s’entend, mais sans ego... Y “accéder”, la “voir”, la “connaître”, la “reconnaître”, la “toucher”, “l’atteindre”, “s’unir avec”, s’y “identifier”, la “réaliser”, etc., comme le fruit de la pratique. Ce serait sans sortir de cette réalité (dharmakāya) que les bodhisattvas enverraient leurs avatars.
Pour ceux qui aspirent à une “réalité supérieure”, au-delà de l’expérience humaine et de “la raison”, cette expérience et “la raison” ne servent qu’à préparer “l’accès”, et éventuellement ensuite à aider d’autres à s’y préparer. Ou parce que la réalité essentielle d’un humain, ignorée par lui, serait divine, même ignorée... Comme dans les traditions hermétiques, le dernier bout (saut) est parcouru par la foi, et “le coeur” en tant qu’organe de la connaissance supérieure, voire de l’Amour divin, transcendant toutes les différences.
Il s’agit donc d’un niveau de réalité et d’une “connaissance” (gnose) superhumaine, au-delà de l’expérience humaine. Ce à quoi les hermétistes (et d’autres) réfèrent avec le terme “Noûs”, qui peut aussi être traduite (voir p.e. prof. dr. Wouter Hanegraaff) comme Lumière (divine), et qu’il faut par conséquent distinguer de la lumière ou des lumières humaines.
Les méthodes de pratique du bouddhisme pāli, et, à mon avis, l’apratiṣṭhāna-madhyamaka (dbu ma rab tu mi gnas pa, non-établissement radical) se situent dans l’expérience humaine, et utilisent les lumières humaines pour accéder à des états a-rationnels et a-discursifs, où ces facultés ne sont pas engagées, sans les nier. Là où le scepticisme pyrrhonien suspend le jugement en attendant (peut-être) une vérité, l'apratiṣṭhāna-madhyamaka montre qu'il n'y a rien sur quoi s'établir, même pas la suspension elle-même. Pas de pratišṭhā (fondement, établissement, demeure) : ni dans l'existence (bhāva), ni dans la non-existence (abhāva), ni dans l'indétermination, ni même dans la vacuité (śūnyatā) comme position. il ne s'agit pas d'une position philosophique, mais d'une pratique du non-établissement qui traverse tous les niveaux d'expérience.
Le Sūtra du Cœur (Prajñāpāramitā Hṛdaya Sūtra) offre un modèle de ce que pourrait être une “gnose” véritablement a-rationnelle et a-discursive - ni contre la pensée conceptuelle, ni construite par elle, mais simplement autre. Sans la poser comme procédant d’une réalité supérieure, en l’associant au divin, à une Conscience pure, ou autre entité métaphysique.
Si de tels états, suscités “artificiellement” (par la posture, le souffle, l’imagination, …) ou naturels, sont expérimentés, faut-il en faire quelque chose ? Les prolonger et faire durer “dans” d’autres états (de veille, rêve, sommeil, …) y compris postmortem ? Que cela changerait-il ? Que cela impliquerait-il pour “la pratique” ? Quelle différence au fond entre être, vivre et agir depuis le non-établissement (apratiṣṭhāna), et l’activité des bodhisattvas réincarnés, “dieux vivants”, avatars ou corps apparitionnels (sprul sku), réputés descendre par amour de leur Dharmakāya, sans toucher terre et sans être recouvert par la boue humaine ? Ceux qui renaissent dans Sukhāvatī sont dits aussitôt retourner sur la terre pour y agir par des corps apparitionnels, sans quitter le Dharmakāya. Que celui qui sait les distinguer d’humains ordinaires lève sa main apparitionnelle.
Il ne reste plus qu'à être, vivre et agir depuis le non-établissement (apratiṣṭhāna)...
***
[1] Traduction par Claude AI.
“Neither reason in general, nor specifically the Hermetic discourse - the word logos may of course mean either - can of itself bring one to the truth. The logos guides the intellect ‘ as far as a certain p o in t’ ; but thenceforth the intellect must proceed on its own, with nothing but réminiscence of the teachings it has received in the sphere of reason to compare its expériences with. In this manner the intellect may eventually attain to faith (πίστις) - ‘ for to have understood is to have believed (τὸ γὰρ νοῆσαί ἐστι τὸ πιστεῦσαι), and not to have understood is not to have believed’. One could hardly wish for a more concise statement of the ancients’ conviction that human and divine knowledge, reason and intuition, are interdependent - a view which continued to prevail in Islam, particularly in Shiite and Sufi circles, but which the Western intellectual tradition has often rejected, decomposing knowledge into independent categories, separating philosophy from theology, and in so doing setting up serious obstacles to the understanding of more unified world-views.” (Fowden 1986)
[2] "Il devrait maintenant être clair que la connaissance de Dieu que l'initiation hermétique est censée apporter n'est pas une connaissance extérieure, d'un être par un autre, mais une assomption effective par l'initié des attributs de Dieu : en bref, la divinisation. La voie d'Hermès est la « voie d'immortalité » ; et son terme est atteint quand l'âme purifiée est absorbée en Dieu, si bien que l'homme rené, bien qu'encore composé de corps et d'âme, peut lui-même être légitimement appelé un dieu." (traduction Claude AI)
“It should be clear by now that the knowledge of God that the Hermetic initiation is supposed to bring is not an external knowledge, of one being by another, but an actual assumption by the initiate of the attributes of God : in short, divinization. The way of Hermes is the ‘ way o f im m ortality’ ;86 and its end is reached when the purified soûl is absorbed into God, so that the reborn man, although still a composite ofbody and soûl, can himself fairly be called a god.” (Fowden 1986).
[3] Traduction par Claude AI.
“Man is a divine being (θεῖον ὄν), to be compared not with the other earthly beings, but with those who are called gods, up in the heavens. Rather, if one must dare to speak the truth, the true Man is above even the gods, or at least fully their equal.
After all, none of the celestial gods will leave the heavenly frontiers and descend to earth; yet Man ascends even into the heavens, and measures them, and knows their heights and depths, and everything else about them he learns with exactitude. What is even more remarkable, he establishes himself on high without even leaving the earth, so far does his power extend. We must presume then to say that earthly Man is a mortal god, and that the celestial God is an immortal man. And so it is through these two, the world and Man, that all things exist; but they were all created by the One.”
[4] “Yet some conception of the transcendence of God (as for example the creator of the All rather than Himself the All) can often be found even in the most immanentist treatises; and as he rose in due course from epistēmē towards gnōsis, the Hermetist was increasingly likely to face the World and Man as of lesser intrinsic interest than God, and to long for knowledge of God rather than merely knowledge about Him. And in this way there might easily arise a tendency to devalue the World and Man and to undermine their integral relationship with God - in other words to cultivate a philosophy of dualist tendency and to emphasize the transcendent nature of the Divinity”. (Fowden 1986)
[5] "In fact, for the Hermetist no product of human intellectual investigation, not even knowledge of God, was an end in itself; for underlying all human thought and action is the desire for release from this world of flux and materiality, for the salvation of the soul. Accordingly, the only truly useful knowledge is that of the way of immortality; and such knowledge was treated, naturally enough, as a treasure whose existence ought not to be casually revealed to all and sundry. It is this dualist, soteriological and esoteric philosophy that lies at the heart of the gnostic systems that were so widely diffused in the Roman empire; and of the pagan aspect of this movement Hermetism is by far the best-documented example.” (Fowden 1986)